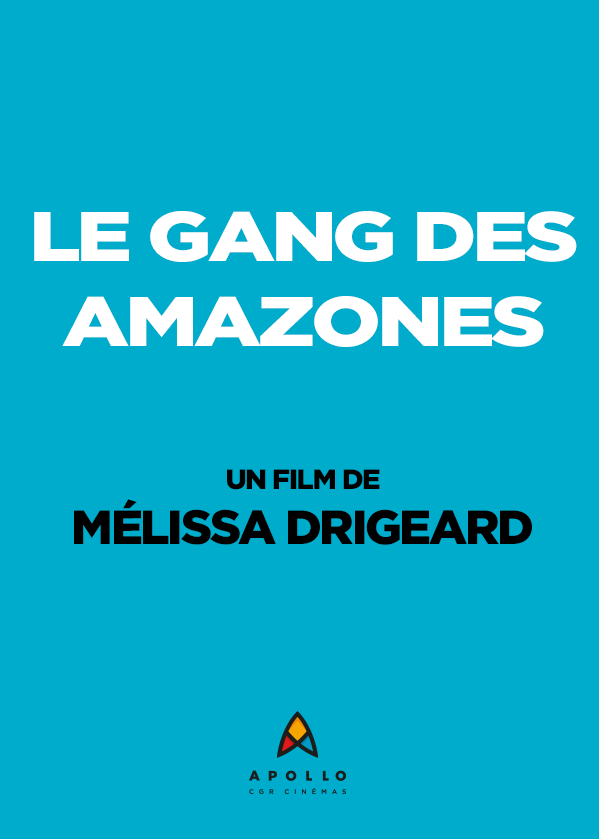Mélissa Drigeard, Cheffe de gang !
Aujourd’hui 12 novembre, sort l’exaltant Gang des Amazones ! Entretien avec une réalisatrice punchy .
Après des débuts au théâtre puis à la télévision, Mélissa réalise une première comédie romantique Jamais le premier soir, suivie de Tout nous sourit (2019). Elle poursuit avec Hawaii (2023), avant de revenir en 2025 avec Le Gang des Amazones, un film inspiré d’une histoire vraie, où elle explore les thèmes de la précarité et de la solidarité féminine. Polyvalente et engagée, Mélissa Drigeard aime mettre en lumière des personnages complexes, souvent féminins, et mêler humour, émotion et réalisme social.
ToutMa : Pourquoi raconter l’histoire du Gang des Amazones ?
Mélissa Drigeard : Mon co-auteur, Vincent Juillet, a écouté l’émission Affaires sensibles de Fabrice Drouelle consacrée au Gang des Amazones. En fait, cette émission s’inspirait elle-même d’un documentaire de Solveig Anspach, réalisé il y a presque trente ans, juste après le procès. Vincent m’en a parlé, je ne connaissais pas du tout cette histoire. J’ai écouté le podcast et je me suis demandé : est-ce que ça dépasse le simple fait divers ? Derrière le grand banditisme, qu’est-ce qu’il y a vraiment ? J’ai alors contacté les vraies Amazones. Trente ans plus tard, elles m’ont fait confiance, et j’ai compris que leur histoire était bien plus vaste et plus riche que ce qui avait été raconté à l’époque.
TM : Comment avez-vous créé l’alchimie entre vos actrices ?
MD : Le sujet était tellement fort que les actrices étaient déjà chargées émotionnellement. Elles ont rencontré les vraies Amazones trois semaines après le début du tournage, lors de la scène du procès. Ce fut un moment merveilleux, et cela a porté toute l’équipe. On a tourné dans des lieux très chargés : de vraies prisons, comme celle de Tarascon, et même dans le tribunal où elles avaient été jugées. Tout ça a nourri le jeu des actrices. Elles sont puissantes, charismatiques, fragiles et fortes à la fois. Chaque jour derrière ma caméra, je me disais : « Waouh ! ». Pour la mise en scène, j’ai choisi de rester au plus près d’elles, surtout du point de vue de Cathy (incarnée par Lyna Khoudri). Beaucoup de plans séquences, pas de champ/contrechamp, pour ne jamais les diluer au milieu des autres personnages.
Je voulais que ce soit elles qui nous emmènent jusqu’au bout du film.
TM : Plus qu’un film de braquage, votre œuvre parle de précarité, de survie et de niches criminogènes. Pour autant, est-ce que sept braquages sont justifiables ?
MD : Ce n’est pas à moi de les juger : il y a eu un procès, et il est dans le film. Ce qui est difficile pour moi, c’est que je me suis liée d’amitié avec Cathy et Hélène. On s’est rapprochées, je les accompagne encore aujourd’hui sur des festivals. Je n’ai jamais voulu en faire des héroïnes, car ce ne sont pas des héroïnes. Mais ce sont des femmes qui ont été confrontées à une misère sociale et affective énormes, dans un milieu où la violence était banalisée. La société d’aujourd’hui n’est pas si différente : à part les téléphones portables et le fait qu’il n’y a plus d’argent dans les banques, ça pourrait être la même histoire. Je me suis posé la question du jugement à l’écriture, au tournage, au montage. La seule réponse que j’ai trouvée, c’était de raconter leur histoire. Le spectateur se fera son propre avis. J’ai travaillé énormément sur la partie du procès. On ne peut pas rendre la réalité d’un procès, mais on peut s’approcher de la vérité, restituer ce que ressentaient les filles, les victimes, les avocats, l’avocat général et même les jurés. Ce qui m’a frappée, c’est l’humanité présente chez tous : les Amazones, leurs avocats, la juge Françoise Saboy… Ce dénominateur commun d’humanité m’a semblé essentiel.
Pour moi, la misère crée la misère. Mais derrière ça, il y a aussi une grande histoire de sororité, et une aventure humaine forte.